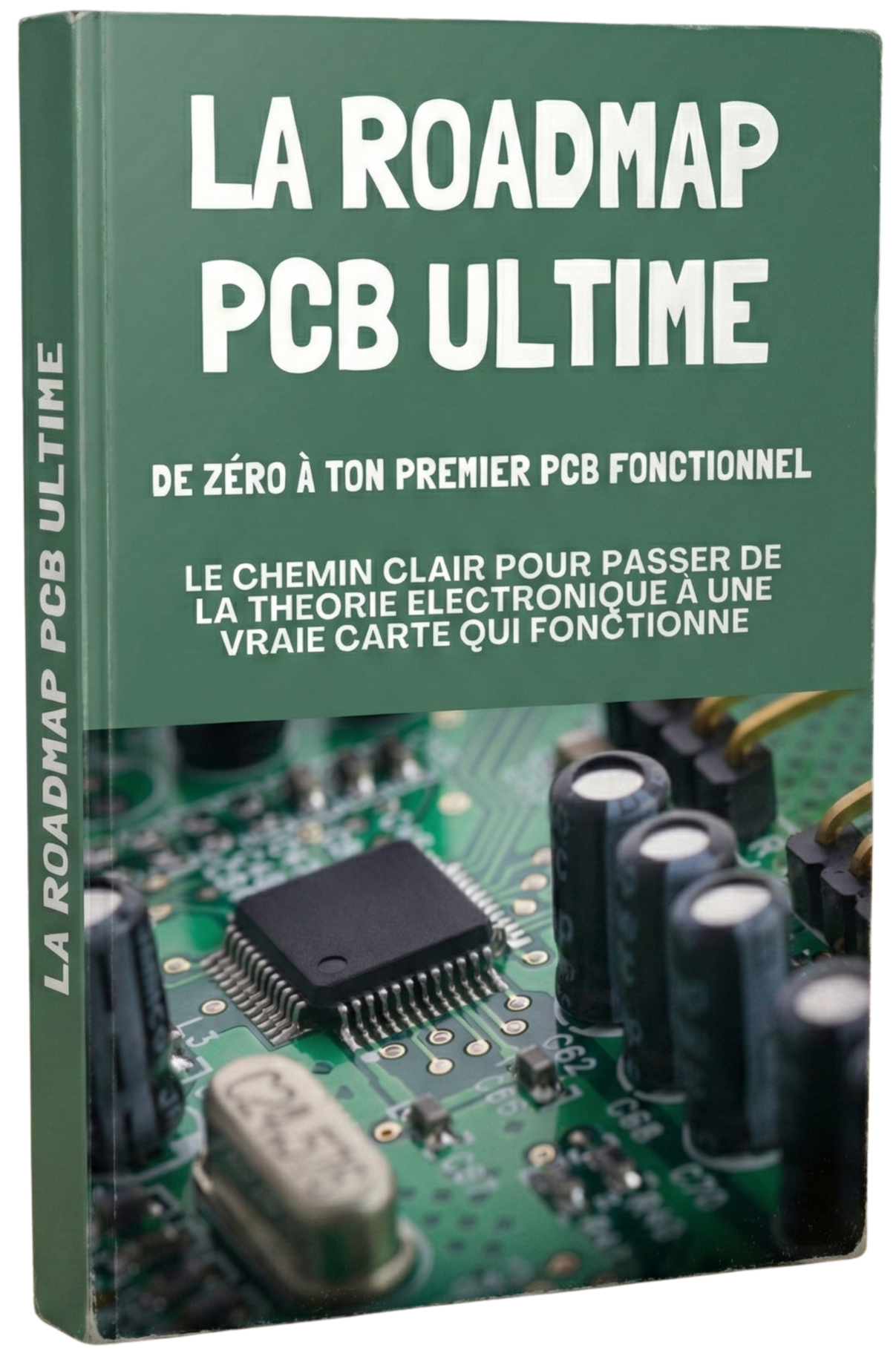Qu’est-ce qu’une photorésistance ?
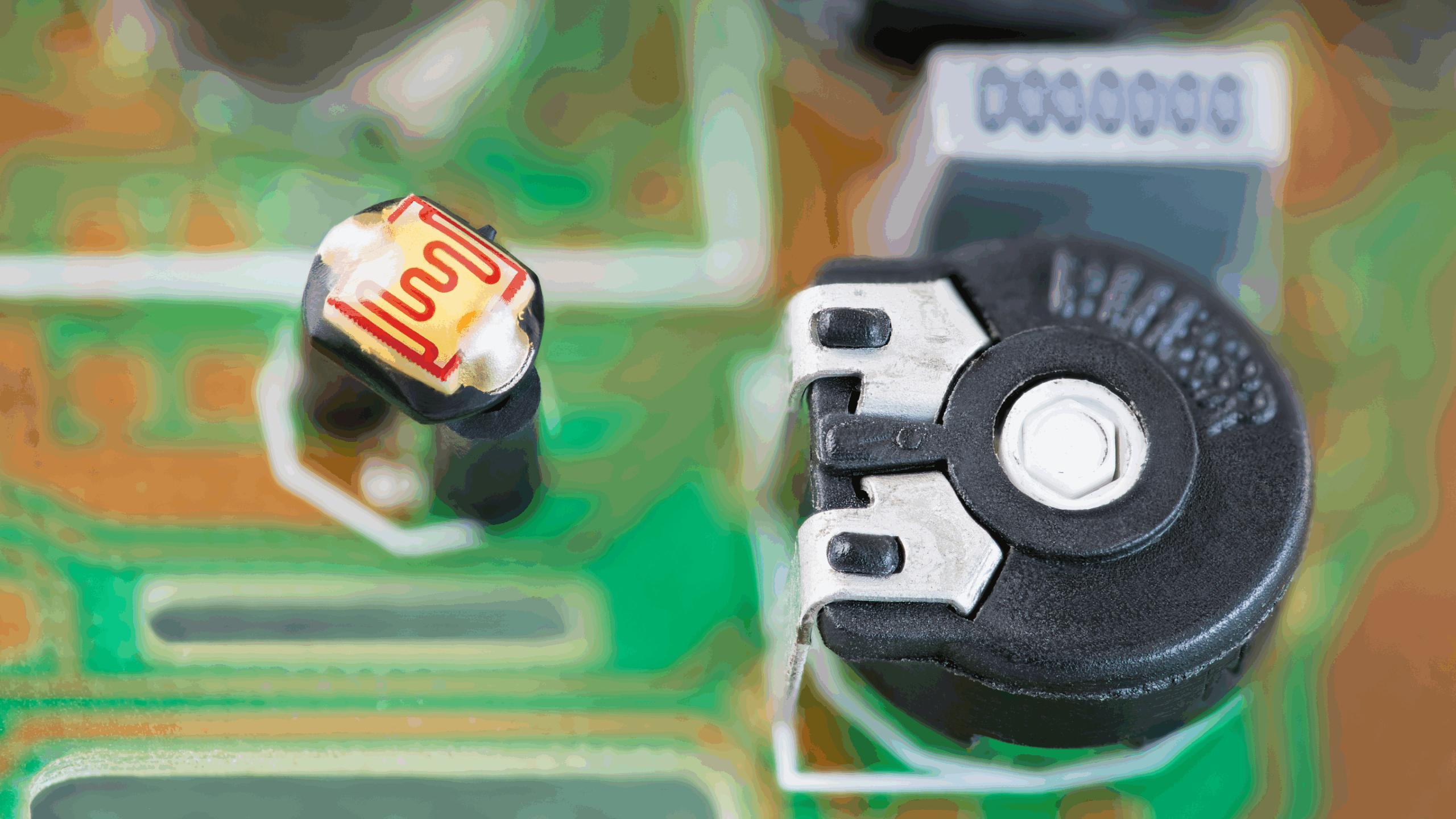
Physique des Matériaux
-
Le sulfure de cadmium (CdS) et le séléniure de cadmium (CdSe) sont les matériaux les plus couramment utilisés pour la détection de la lumière visible. Le CdS, en particulier, est très populaire car sa courbe de réponse spectrale est remarquablement similaire à celle de l’œil humain, avec un pic de sensibilité autour de 520 nm (la couleur verte). Le CdSe offre une réponse plus rapide que le CdS, au prix d’une sensibilité plus étendue vers l’infrarouge.
-
Le sulfure de plomb (PbS) et l’antimoniure d’indium (InSb) sont utilisés pour des applications dans la région de l’infrarouge. Leurs propriétés les rendent essentiels pour des dispositifs spécialisés tels que les capteurs thermiques ou les systèmes de vision nocturne.
-
Le silicium (Si) est une alternative de plus en plus pertinente. Bien que sa sensibilité maximale se situe dans le spectre rouge et infrarouge, le silicium offre une robustesse supérieure face à la température et à la contamination.
Caractéristiques Électriques et Optiques
La photorésistance est un composant caractérisé par des propriétés qui la distinguent nettement d’autres capteurs optiques. La compréhension de ces spécificités est essentielle pour toute conception de circuit.
Non-linéarité et Sensibilité
Temps de Réponse
Autres Facteurs
La résistance d’une LDR est également sensible aux variations de température ambiante. Même si l’intensité lumineuse est maintenue constante, un changement de température peut faire varier la résistance du composant de manière significative. Cette dépendance rend les photorésistances peu fiables pour des mesures précises et stables sur le long terme. Enfin, comme tout composant passif, les photorésistances ont des limites de tension et de puissance dissipable qu’il est impératif de ne pas dépasser pour éviter leur dégradation.
Le tableau suivant résume les caractéristiques typiques d’une photorésistance au sulfure de cadmium, couramment utilisée :
| Caractéristique | Valeur typique | Description |
|---|---|---|
| Résistance à l’obscurité | >1MΩ | Mesurée sans aucune lumière ambiante |
| Résistance à la lumière | <1kΩ | Mesurée sous un éclairement ambiant modéré |
| Temps de réponse (obscurité -> lumière) | ≈10ms | Temps nécessaire pour que la résistance chute |
| Temps de réponse (lumière -> obscurité) | ≈1s | Temps nécessaire pour que la résistance remonte |
| Pic de sensibilité spectrale | ≈520nm | Correspond à la lumière verte, proche de la sensibilité de l’œil humain |
| Puissance dissipable typique | Limite de dissipation de puissance pour un modèle comme le GL-5525 |
Conception de Circuits et Applications
La simplicité de son utilisation fait de la photorésistance un composant de choix pour de nombreux projets électroniques, qu’ils soient éducatifs ou commerciaux. La configuration la plus simple et la plus courante est le montage en pont diviseur de tension.
Le Pont Diviseur de Tension
-
Si la photorésistance est placée en position (configuration pull-down), la tension de sortie est mesurée aux bornes de la résistance fixe . Lorsque la lumière augmente, la résistance de la LDR () diminue, ce qui a pour effet de faire augmenter la tension de sortie . C’est une relation directe : plus il y a de lumière, plus la tension de sortie est élevée.
-
Si la photorésistance est placée en position (configuration pull-up), la tension de sortie est mesurée aux bornes de la LDR. Lorsque la lumière augmente, la résistance de la LDR () diminue, ce qui fait chuter la tension de sortie . C’est une relation inverse : plus il y a de lumière, plus la tension de sortie est basse.
Cette simple inversion du placement permet au concepteur de choisir si son circuit doit être activé par un niveau de tension haut ou bas, offrant une flexibilité précieuse pour les montages de détection.
Étude de Cas
-
En plein jour : La photorésistance est exposée à une forte luminosité, sa résistance est donc à son minimum. La tension de sortie du pont diviseur (si la LDR est en position pull-down) est faible, ce qui n’est pas suffisant pour saturer la base d’un transistor. Le transistor reste bloqué, aucun courant ne circule vers le relais, et l’ampoule reste éteinte.
-
Dans l’obscurité : La luminosité diminue. La résistance de la photorésistance augmente fortement, pouvant atteindre 1 MΩ. La tension de sortie du pont diviseur augmente en conséquence, atteignant un niveau suffisant pour saturer le transistor. Le transistor devient passant, le courant active la bobine du relais, qui ferme les contacts et allume la charge lumineuse.
Autres Applications
La polyvalence de la photorésistance est illustrée par la diversité de ses applications :
-
Éclairage automatique : Allumage et extinction des lampadaires publics ou des veilleuses nocturnes.
-
Systèmes de sécurité : Détection d’intrusion en cas de coupure d’un faisceau lumineux (par exemple, un laser) dans une alarme antivol.
-
Photométrie : Mesure de l’intensité lumineuse dans les anciens appareils photo pour régler l’exposition.
-
Automatisme et domotique : Utilisation dans les horloges d’extérieur, les serres pour ajuster l’irrigation ou l’ombrage, ou pour le contrôle des rideaux.
Comparaison avec les Capteurs Optiques Alternatifs
| Caractéristique | Photorésistance (LDR) | Photodiode | Phototransistor |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Passif, Résistance qui diminue avec la lumière | Actif, Génère un courant | Actif, Amplifie le courant généré par la lumière |
| Sensibilité | Raisonnable mais faible | Élevée, bonne pour la détection précise | Très élevée grâce à l’amplification |
| Temps de réponse | Lent (10 ms à 1 s) | Très rapide (nanosecondes) | Rapide (microsecondes), plus lent que la photodiode |
| Linéarité | Non-linéaire | Linéaire | Non-linéaire |
| Polarité | Aucune polarité | Polarité directionnelle (anode/cathode) | Polarité directionnelle (émetteur/collecteur) |
| Coût et Complexité | Très faible coût, simple à utiliser | Plus coûteux, nécessite souvent un circuit d’amplification | Plus coûteux, sensibilité à la tension de polarisation |
| Applications Typiques | Détection tout ou rien (éclairage public), projets éducatifs | Communications optiques, lasers, mesures précises de lumière | Détecteurs de lumière haute sensibilité |
Il ressort de cette comparaison que chaque capteur a un rôle spécifique. Bien que les photodiodes et les phototransistors surpassent la photorésistance en termes de sensibilité, de vitesse et de précision, la LDR conserve un avantage concurrentiel indéniable : sa simplicité et son faible coût. Son fonctionnement passif, son absence de polarité et sa grande robustesse la rendent idéale pour les applications où la précision n’est pas un critère primordial. Cette dichotomie explique pourquoi la photorésistance continue d’être largement utilisée dans les produits de consommation courants, les kits de démarrage en électronique et les prototypes à faible budget, même si d’autres technologies existent.
Limites et Dépannage des Circuits à Photorésistance
Malgré sa simplicité, la photorésistance présente des limitations et les circuits qui l’utilisent peuvent rencontrer des problèmes courants.
Les principales limites, déjà évoquées, incluent sa non-linéarité, son temps de réponse lent et sa dépendance à la température, qui rendent les mesures précises difficiles. Cependant, pour des applications de commutation, ces limitations sont gérables.
En cas de dysfonctionnement d’un circuit à photorésistance, une démarche de dépannage systématique est nécessaire :
- Tester la photorésistance elle-même : Avant de chercher un problème dans le circuit, il est essentiel de vérifier que la LDR fonctionne correctement. Un multimètre en mode ohmmètre permet de le faire facilement. Dans l’obscurité, la résistance doit être très élevée (plusieurs mégaohms). En exposant le capteur à une source lumineuse (comme la lumière d’une torche), la résistance doit chuter significativement, généralement jusqu’à quelques centaines d’ohms.
- Vérifier le circuit : Le problème le plus fréquent pour les débutants est l’interférence lumineuse. La lumière émise par la charge (par exemple, une LED) peut frapper la photorésistance, créant une boucle de rétroaction non désirée et empêchant le circuit de basculer correctement. La solution est simple : il faut éloigner les composants ou utiliser un écran pour les séparer.
- Ajuster la résistance de charge : Le choix de la résistance fixe dans le pont diviseur est critique. Si sa valeur est trop élevée ou trop basse, la tension de sortie du pont ne variera pas suffisamment pour atteindre le seuil de basculement d’un transistor ou d’une entrée numérique. Un potentiomètre est une excellente solution pour ajuster finement ce seuil et calibrer la sensibilité du circuit.
- S’assurer de la bonne mise à la terre : Les problèmes de masse sont une autre cause fréquente de dysfonctionnement. Il est crucial de s’assurer que tous les composants partageant un point de référence (le ground) sont correctement connectés.
Aspects Réglementaires et Alternatives Modernes
L’utilisation de la photorésistance est également soumise à des considérations réglementaires, en particulier en Europe. La directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a sévèrement restreint l’usage de certains matériaux dans les composants électroniques, notamment le cadmium. En conséquence, l’utilisation des photorésistances au sulfure de cadmium (CdS) et au séléniure de cadmium (CdSe) est très limitée dans les produits neufs fabriqués pour le marché européen.
Cette contrainte réglementaire a poussé les fabricants à se tourner vers des alternatives. Les capteurs à base de silicium, qu’il s’agisse de photodiodes ou de phototransistors, sont devenus une solution de remplacement privilégiée. Le silicium est non seulement conforme à la directive RoHS, mais il offre également une plus grande résistance aux températures extrêmes et à la contamination.
Cependant, comme discuté précédemment, les capteurs au silicium n’ont pas la même sensibilité spectrale que les photorésistances au CdS, leur réponse étant principalement axée sur les longueurs d’onde rouges et infrarouges. Pour les applications qui nécessitent une réponse proche de celle de l’œil humain, comme le contrôle de l’éclairage de rue, il est possible d’intégrer des filtres optiques (en verre ou en polymère) devant le capteur au silicium. Ces filtres absorbent les longueurs d’onde indésirables, permettant de combiner la conformité réglementaire et la robustesse du silicium avec une courbe de réponse adaptée à l’usage souhaité.
En conclusion, la photorésistance demeure un composant fondamental et très pertinent en électronique. Malgré ses limitations bien connues (non-linéarité, latence, sensibilité à la température) et les défis réglementaires liés au cadmium, sa simplicité, son faible coût et son efficacité pour les applications de commutation et de détection binaire lui garantissent une place de choix durable dans les projets de bricolage, les kits d’apprentissage et les produits de consommation où la haute précision n’est pas le critère principal. Elle n’est pas un composant obsolète, mais plutôt un outil de base qui a trouvé sa niche dans un écosystème électronique de plus en plus sophistiqué.
Autres articles :